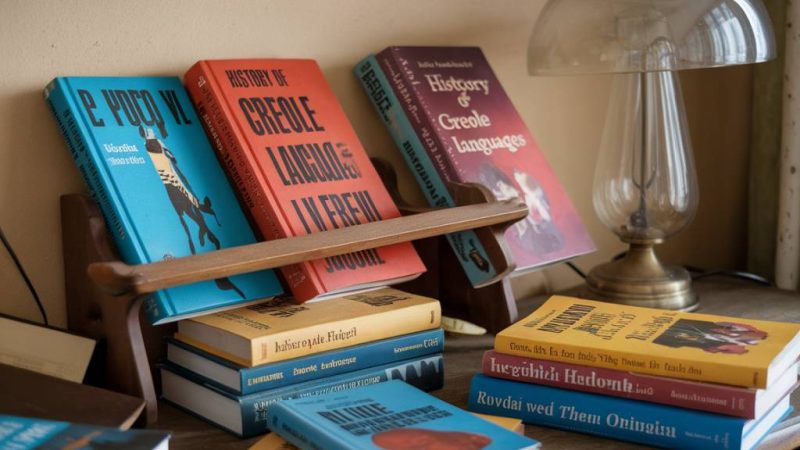La redécouverte des instruments de musique traditionnels

Un patrimoine sonore à retrouver
Dans l’imaginaire collectif, les territoires d’Outre-mer évoquent des paysages foisonnants, une biodiversité exceptionnelle, des créoles chantants… et parfois, la puissance rythmique d’un tambour ancestral. Pourtant, derrière l’évidence sonore, des pans entiers de notre patrimoine musical restent, sinon silencieux, du moins assourdis. La redécouverte des instruments de musique traditionnels des Outre-mer s’inscrit dans un mouvement plus large : celui d’une reconnexion culturelle, d’un ancrage profond dans les héritages pluri-centenaires, souvent effacés ou réduits à des folklorisations en vitrine. Mais aujourd’hui, les choses changent. Et vite.
De la Guadeloupe à Tahiti, en passant par Mayotte ou la Guyane, des artisans, musiciens, enseignants et chercheurs s’activent comme des archéologues du son pour faire revivre ces trésors instrumentaux. Ils ne collectent pas des reliques : ils réaniment des voix en bois, en peau, en calebasse, en conque… et nous offrent un voyage sensoriel au cœur de l’identité et de la mémoire.
Quand le tambour parle, les mémoires s’éveillent
Difficile de parler des instruments traditionnels d’Outre-mer sans évoquer l’incontournable tambour. Pourtant, il en existe une diversité insoupçonnée. Prenez le ka en Guadeloupe : ce tambour à double ouverture fait partie des fondations du gwo ka, un genre musical inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Au-delà du rythme, c’est un langage corporel, une méthode d’improvisation, un passage de témoin entre anciens et jeunes générations, qui se transmet sans partition.
Mais connaissez-vous le bobre de La Réunion, ce mystérieux arc musical d’origine africaine, fixé à une calebasse et joué au bâton ? Utilisé autrefois pour accompagner les chants de labeur ou de résistance, il revient aujourd’hui dans les studios et dans les cours d’écoles, porté par des artistes comme Danyèl Waro ou des projets associatifs qui enseignent l’histoire à travers chaque vibration.
Et à côté des stars du patrimoine sonore, d’autres instruments plus discrets retrouvent peu à peu leur place, comme le tôhoka bushinenge en Guyane – xylophone sur tronc creusé et feuillage – ou les nombreuses percussions en coquillages polynésiens qu’exploitent encore certaines communautés lors de cérémonies culturelles.
Des luthiers de territoire
Pas d’instruments traditionnels sans artisans pour les fabriquer. Et là encore, la redécouverte passe par un renouveau des savoir-faire. Dans l’archipel de Wallis-et-Futuna, plusieurs jeunes artisans se forment à la fabrication du lali, un tambour creusé dans le tronc d’un arbre sacré, encore utilisé pour émettre des signaux sonores dans les villages.
À Mayotte, des projets collaboratifs réunissent anciens et jeunes autour de la fabrication de gabous, petits tambours traditionnels au rôle à la fois musical et spirituel. L’essence même du renouveau tient dans ce lien rétabli entre terre, matériau, geste et son. On n’achète pas un instrument traditionnel, on le crée, on l’écoute naître, on le respecte.
Certains ateliers vont encore plus loin, en ralliant écologie et tradition. C’est le cas en Nouvelle-Calédonie où plusieurs initiatives valorisent des bois endémiques et des matériaux naturels dans la recréation d’instruments kanak, évitant ainsi l’industrialisation au profit d’un travail lent, artisanal et écosystémique.
L’école, terrain fertile ou terrain désert ?
Peut-on vraiment reconstruire un lien avec les instruments traditionnels si ceux-ci ne sont jamais évoqués dans les programmes scolaires ? Cette question, beaucoup d’acteurs la posent. Heureusement, plusieurs initiatives pédagogiques innovantes tentent de remédier à ce déficit d’acculturation.
À Tahiti, des écoles primaires organisent des ateliers hebdomadaires d’initiation au pahu, grand tambour cérémoniel utilisé dans les danses ori tahiti. En Martinique, grâce à des associations comme l’AMEP (Association martiniquaise d’éducation populaire), les élèves peuvent découvrir le ti bwa, ces deux morceaux de bois frappés ensemble, qui accompagnent les rythmes du bèlè, musique fondamentale de l’île.
Mais tout cela reste souvent le fruit d’initiatives individuelles ou ponctuelles. Quand on sait combien la musique forge l’identité culturelle, ne serait-il pas temps de faire une place plus solide aux instruments traditionnels dans le socle commun des connaissances transmises à l’école ?
Des sons pour danser, ou pour résister ?
Si les instruments traditionnels reviennent aujourd’hui sur le devant de la scène, ce n’est pas uniquement pour des raisons esthétiques. Ces instruments sont les témoins sonores d’une mémoire collective, souvent marquée par l’esclavage, la colonisation, l’exil ou encore la répression culturelle.
En Haïti, redécouvrir et jouer le vaccin ou les conques de lambis dans les cérémonies Rara, c’est affirmer une identité populaire souvent marginalisée. En Guyane, ressortir le kalimba lors de veillées bushinenge, relève autant de la transmission que de la revendication. Partout, le son devient contrepoids à l’oubli, antidote aux effacements de l’histoire officielle.
La scène contemporaine s’en empare
Que fait la jeunesse de ces redécouvertes ? Elle les transforme, les hybride, les réinvente. De nombreux artistes ultramarins d’aujourd’hui s’emparent des instruments traditionnels comme matière vivante à expérimenter. À l’image de Vaïana Pahuiri en Polynésie française, qui fusionne ukulele traditionnel et électro planante. Ou encore du Guadeloupéen Sonny Troupe, batteur et percussionniste, qui revisite le tambour ka au sein du jazz contemporain.
Certaines formations vont même jusqu’à réintroduire des sons oubliés dans la musique urbaine ou électronique. Le tambour bèlè s’invite dans les samples de beatmakers martiniquais, tandis que des créateurs comme Toko Blaze (Réunion) sample le bobre sur fond de reggae-ragga ardent.
Le message est clair : cet héritage est vivant, mouvant, et sans cesse réinventé. Il ne s’agit pas de figer les sons dans des musées, mais bien de leur redonner leur capacité à dialoguer avec leur époque.
Où les écouter, où les apprendre ?
Pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir ces instruments de manière concrète, de nombreuses pistes s’offrent à eux.
- Les festivals de musique traditionnelle ou autochtone comme Musique Métisse (Guyane), Tempo Festival (La Réunion) ou Festival des Arts des îles Loyauté (Nouvelle-Calédonie) proposent régulièrement des performances et ateliers pratiques.
- Certains centres culturels comme le CMAC (Fort-de-France), le Centre Culturel Tjibaou (Nouméa), ou encore le Conservatoire artistique de Polynésie française accueillent toute l’année des stages de fabrication ou de pratique.
- Youtube et les réseaux sociaux deviennent aussi une mine pour les jeunes générations désireuses de réapprendre en autonomie : des chaînes consacrées au tambour ka, au bobre ou au pahu se multiplient, souvent gérées par les musiciens eux-mêmes.
Ces outils numériques, s’ils peuvent paraître déconnectés de la matérialité des instruments, jouent un rôle d’accélérateur de la transmission. Car pour que le bobre ou le kalimba ne soient pas des pièces de musée, encore faut-il que les plus jeunes puissent y avoir accès… même via un écran.
Un instrument, une histoire, une âme
Redécouvrir les instruments de musique traditionnels ultramarins, ce n’est pas simplement enrichir une discothèque exotique. C’est poser l’oreille sur des histoires longtemps tues, reconnecter les gestes et les sons à une terre, à un imaginaire. Et surtout, c’est comprendre que ces objets sonores ne sont jamais neutres : ils portent en creux les joies d’un peuple, ses luttes, ses chants d’amour, ses cris de résistance.
Là où nos sociétés modernes avancent souvent à coup de dématérialisation sonore, le retour aux instruments traditionnels ancre : dans le bois, dans la peau, dans le souffle. Il s’agit alors de ne pas simplement les écouter, mais de les entendre pleinement, dans tout ce qu’ils racontent sans parler.
Une simple conque vide, un arc tordu par un fil, deux bouts de bois taillés… Et c’est tout un monde qui reprend vie.